- Accueil
- > Revue électronique
- > Lectures de la première fois. Lectures d’enfance ...
- > Présentation
Présentation
Par Pierre Loubier et Antonia Zagamé
Publication en ligne le 04 février 2021
Article au format PDF
Présentation (version PDF) (application/pdf – 663k)
Texte intégral
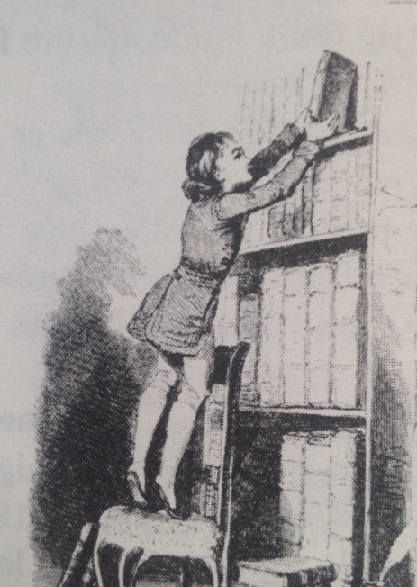
Rodolphe Töpffer, « La bibliothèque de mon oncle », Nouvelles genevoises, (1832)
Éditions Dubochet, 1845, p. 18, dessin de l'auteur
Sinon l’enfance, qu’y avait-il alors qu’il n’y a plus ?
(Saint-John Perse, « Pour fêter une enfance », Éloges, 1911)
1Qu’est-ce c’est que faire l’expérience d’un genre ? se demandent Marielle Macé et Raphaël Baroni dans Le Savoir des genres1. Comment le prisme du genre littéraire agit-il durant la lecture ? Pour poser cette question un peu différemment, ce numéro des Cahiers du FoReLLIS a choisi de prendre pour objet la représentation des lectures d’enfance, avec l’idée que celles-ci peuvent offrir la possibilité de se demander ce qu’est, au rebours de la situation la plus répandue, une lecture sans connaissance, sans conscience génériques. Lorsque sa mère lit au petit Marcel, dans Du côté de chez Swann2, François le Champi, celui-ci dote l’œuvre de George Sand de qualités extraordinaires parce que c’est le premier roman qu’il lit et qu’il ne sait pas que certaines de ses qualités sont propres à tous les romans… L’enfant ne maîtrise pas encore le répertoire générique que se constitue plus tard le lecteur, ce « système d’attentes et de capacités à percevoir les modulations, qui crée l’habitus d’un regard générique global (…) ou d’une conscience de genre3 ».
2Or, la situation qu’on trouve évoquée dans La Recherche du Temps perdu est caractéristique d’un certain nombre d’expériences de lectures qu’on pourrait appeler les « lectures de la première fois » ; elle peut servir à qualifier une première lecture, d’enfance ou de jeunesse, d’autant plus marquante et décisive qu’on ne maîtrise pas encore les codes du genre, que la réception n’est pas guidée par une forme de routine qu’on va acquérir ensuite, avec ce savoir générique « qui est la trace de nos expériences esthétiques4 ».
3C’est en nous intéressant à la démarche empirique du sujet-lecteur que nous avons choisi de nous interroger sur les lectures d’enfance ou de jeunesse : sans exclure d’autres domaines, comme celui de la fiction romanesque, l’enquête accorde une valeur particulière aux témoignages de lecture, avec une prédilection pour les souvenirs de lectures d’enfance des écrivains, qui se sont avérés un riche champ d’étude. L’empan chronologique relativement large de la réflexion, des Lumières au contemporain, permet de suivre l’évolution de ces récits dans le domaine français du XVIIIe au XXIe siècle, de Jean-Jacques Rousseau à Jean-Paul Goux, c’est-à-dire depuis que l’enfance est apparue comme une période fondatrice dans la vie du sujet5.
4Pour mieux cerner les caractéristiques de cette lecture enfantine « hors genre », ou présupposant au moins théoriquement une virginité entière en matière de « compétences génériques », nous avons proposé aux participants de ce numéro trois directions : décrire cette rencontre première, dénuée de toute familiarité, avec le texte et le genre auquel il appartient ; envisager les retentissements éventuels de cette découverte sur la vie ou la vocation du lecteur ; observer l’acquisition d’un répertoire générique susceptible de guider progressivement les lectures.
5Comment se passe, à un niveau très concret, la rencontre avec un texte dont on ne maîtrise pas les codes, avec les règles duquel on n’est pas familier ? Dans lequel on n’identifie pas d’emblée « la part de généralité et de "connu"6 », comme la part d’unique et de singulier ? Comment s’effectue dans ces conditions la communication entre le texte et son lecteur ? Rousseau, dans l’Émile, essaie de reconstituer comme le montre Antonia Zagamé, ce qu’est au juste la lecture d’un enfant de dix ans découvrant La Fontaine sans posséder la maîtrise des codes littéraires susceptibles de rendre cet auteur parfaitement intelligible : constatant le trouble que provoque cette lecture, le pédagogue retire bien vite son livre à l’enfant… Pour beaucoup d’écrivains évoqués dans le recueil, cette rencontre première avec les livres sans le filtre du savoir générique agit toutefois plutôt comme un « charme » : la découverte des romans de Jules Verne par Julien Gracq enfant relève pour lui de l’« opération féérique », comme le montre Marie-Annick Zaninger. Ce regard ébloui du jeune lecteur n’est plus celui de l’écrivain, mais il le retrouve pourtant profondément enfoui lorsqu’il relit, en lecteur confirmé, cette œuvre aimée.
6Dans quelle mesure ces lectures de la « première fois » constituent-elles une rencontre mémorable, qui souvent décide d’une vie, d’une vocation ? En quoi ces lectures de découverte sont-elles en ce sens des lectures révélation – alors même qu’elles paraissent parfois placées sous le signe de la contingence (le hasard fait que telle œuvre donnée est le premier roman, le premier poème qu’on lit…) ? S’appuyant sur une expression de George Sand, Nicolas Fréry montre comment, à partir du XVIIIe siècle, les premières lectures d’enfance deviennent un véritable « événement intime », dont le retentissement est souvent décisif. Évoquer le souvenir des textes que lisait à voix haute son père permet à Lamartine de retracer l’éveil, dès l’enfance, de sa nature poétique, ainsi que le suggère Pierre Loubier. Quant à Yves Bonnefoy, Patrick Née montre que ce sont ses premières lectures de fictions narratives, romans policiers, d’aventures ou récits fantastiques, qui provoquent de manière imprévue sa découverte du poétique : l’enfant, qui lit en dehors du cadre des classifications génériques traditionnelles, se révèle capable de saisir la force poétique de motifs tirés de récits parfois déconsidérés selon la hiérarchie des adultes. Cela signifierait donc que l’impulsion créatrice, poétique en l’occurrence, dépasse la connaissance ou la reconnaissance du genre.
7Comment se déroulent les lectures suivantes, lectures intermédiaires qui n’ont plus l’intensité de la première, mais qui bénéficient de premiers repères intertextuels susceptibles de les guider ? Comment s’acquiert progressivement la « compétence » générique et que modifie-t-elle dans le rapport du lecteur au texte ? Déborah Lévy-Bertherat, dans l’article qu’elle consacre à Nathalie Sarraute, considère les scènes de lecture rapportées dans Enfance comme un apprentissage en plusieurs temps du rapport à la fiction : par l’intermédiaire des albums ou de la littérature de jeunesse, la jeune héroïne expérimente sur plusieurs modes la « porosité » des frontières entre réel et fiction. L’article d’Alix Mary sur Jean-Paul Goux montre enfin qu’une lecture révélation peut advenir en aval, sur fond d’expériences passées jugées décevantes : c’est en lisant les Chants de Maldoror de Lautréamont et Au château d’Argol de Gracq au lycée, que Jean-Paul Goux découvre une autre potentialité du genre romanesque, guère actualisée jusque alors dans les fictions dont la lecture lui avait été recommandée par l’institution scolaire et le milieu familial.
8Les différentes études qui composent ce recueil ont été présentées en deux occasions ; d’abord sous la forme d’une journée d’études en juin 2018 organisée par Patrick Née, alors responsable de l’équipe B2 du laboratoire FoReLLIS7 et Antonia Zagamé, puis d’une demi-journée d’études en octobre 2019, organisée par Pierre Loubier, nouveau responsable de l’équipe, et Antonia Zagamé. Ces deux séances s’inscrivent dans le cadre des travaux de réflexion sur l’axe choisi par l’équipe : « La lecture et les genres ». Nous les présentons ici, en renouvelant tous nos remerciements aux oratrices et orateurs, dans l’ordre chronologique de l’histoire littéraire, afin de composer le parcours de cette réflexion, dont l’analyse des différentes étapes fera apparaître la cohérence et les variations.
9Nicolas Fréry, tout d’abord propose un panorama du siècle qui vit se prolonger, s’approfondir et se complexifier à la fois le questionnement sur l’éducation et la réflexion métalittéraire. La lecture est au centre de cette double approche. Les nombreux exemples fournis permettent de voir se dessiner conjointement des bases thématiques et une trajectoire critique voire théorique pour la réflexion sur les périodes ultérieures. Un certain nombre de topoï se confirment et s’affirment quant à l’imaginaire de la lecture : innutrition, ignition, découverte d’une vocation d’auteur, développement psycho-intellectuel de l’enfant, phénomènes de l’identification, merveilles et dangers de la lecture, notamment pour ce genre « pernicieux » qu’est le roman. On voit que la notion de scène de lecture apparaît déjà comme fondatrice, archaïque ou originelle et qu’elle entre pleinement dans la topique du genre de l’écriture de soi au sens large (récits d’enfance, mémoires, réflexion sur l’éducation également). C’est pourquoi la notion de première fois s’apparente déjà à la rencontre amoureuse et à la relation désirante, que l’on retrouvera dans les siècles suivants abordés dans les études ultérieures du présent recueil. La première lecture est un événement existentiel, mais aussi esthétique car elle forme non seulement le caractère et l’esprit mais aussi le goût.
10Antonia Zagamé confirme et spécifie cette approche panoramique par l’étude précise du rapport de Rousseau aux premières lectures dans cette fiction pédagogique qu’est l’Émile. On verra que la notion de « compétence générique » se trouve au centre de la réflexion à propos de la fameuse lecture de la fable de La Fontaine « Le corbeau et le renard ». Pour Rousseau, nous dit Antonia Zagamé, « l’enfant ignore ce que sont la poésie, la fiction, l’ironie, l’allégorie », et c’est pourquoi il convient de différer l’âge des premières lectures. Au lieu de conclure sur la possibilité ou la nécessité d’une pratique formatrice et progressive de la lecture, capable de combler les incompétences de l’enfant, Rousseau choisit une autre voie, plus radicale. Il convient de former l’homme avant le lecteur. L’appréciation esthétique (la formation du goût) n’apparaît que plus tard, au terme d’une longue éducation sans livres ou presque, et se fera d’autant plus efficace qu’elle aura été opérée sans schèmes de compréhension littéraire, ou générique, prédéfinis. Cet apparent paradoxe débouche sur une conclusion à méditer : « Dans l’Émile, il faut apprendre à vivre afin de pouvoir lire ».
11Pierre Loubier prolonge d’une certaine façon la réflexion sur ce paradoxe en montrant que, pour Lamartine, fervent lecteur de Rousseau, la première lecture se fait à la fois découverte, révélation de l’univers magique du langage et des images créées par la lecture, mais aussi confirmation intérieure d’une vocation à la création littéraire. Lamartine se vivait poète avant même de pouvoir reconnaître et lire la poésie. Ainsi s’élabore, de scène en scène, une recomposition mythographique de la destinée d’un poète : on devient poète lyrique, on devient Lamartine, en rencontrant la voix du Père, le souffle de la Mère, le génie créateur des modèles. L’identification se fait ici non pas à des personnages de romans, mais à des figures, voire des modèles héroïques que sont les poètes en tous genres. Ce qui importe, avant toute connaissance ou reconnaissance génériques, c’est l’appropriation d’une puissance créatrice (le génie), qui transcende en quelque sorte la notion trop restrictive de genres et sous-genres littéraires : on peut l’appeler Poésie. La pure lecture de la première fois est celle qui s’opère en lisant pour la première fois son propre texte et en découvrant la puissance d’attraction du livre.
12Les deux études suivantes confirment de manière parallèle cette conception romantique de la lecture d’enfance comme avènement d’une vocation littéraire : Marie-Annick Gervais-Zaninger montre en effet que, chez Julien Gracq, la lecture de l’œuvre de Jules Verne est dotée d’un ascendant très puissant, d’ordre libidinal. Dans les romans d’aventures lus avec ferveur, Gracq découvre voire reconnaît une force génératrice, qui, elle aussi, transcende la hiérarchie et la définition des genres parce qu’elle se place sous le signe du charme. La découverte de la forme romanesque en sa phase « primitive » est capitale car elle génère un imaginaire romanesque propre et commun à la fois, par une sorte d’imprégnation profonde. Que ce soit dans sa dynamique générale ou dans certains de ses motifs (l’île, le pôle, la carte) cet imaginaire est littéralement séminal.
13Patrick Née va dans le même sens, par le choix qu’il fait de nous montrer l’importance des premières lectures romanesques d’un grand poète et essayiste : Yves Bonnefoy. Ces lectures romanesques se préoccupent peu de la hiérarchie des genres et des sous-genres. Ce qui est privilégié est bien la pulsion poétique : « la question d’une prise de conscience générique précoce se trouve constamment déplacée sur un plan transcendant les distinctions poéticiennes traditionnelles, dans la mesure où le tri qu’a opéré la mémoire ayant gardé vives ses premières émotions […] les situe toutes, qu’elles aient été suscitées par des romans, du théâtre ou des vers qu’on reconnaît ordinairement comme des poèmes, sur le plan de l’expérience poétique elle-même, entendue comme un en deçà, ou un au-delà des distributions génériques reçues ». La première lecture a partie liée avec l’indéfait originel, antérieur à tout langage. Comme chez Lamartine, le langage, pour Yves Bonnefoy, peut magiquement produire la présence. Il est poésie, au-delà des genres. Il donne accès à un Ailleurs, mais aussi, parfois, au négatif, car les lectures de la première fois peuvent tenir du mauvais rêve, au demeurant tout aussi fondateur.
14Déborah Lévy-Bertherat analyse elle aussi le versant parfois traumatique de la lecture de la première fois à travers une étude de l’intertextualité à l’œuvre dans Enfance de Nathalie Sarraute. Comme chez Lamartine, Gracq ou Bonnefoy la force de l’image (mentale et/ou du livre illustré) est signalée comme fondatrice. Nathalie Sarraute parvient à déjouer les pièges et séductions du récit d’enfance, « les facilités de l’autobiographie » (on voit le chemin effectué depuis les Confessions de Rousseau) notamment dans son traitement de la scène stéréotypique de la première lecture. Mais, nouveau paradoxe « parce qu’elles appartiennent justement aux "lieux communs", aux territoires partagés des souvenirs d’enfance, les premières lectures s’investissent, dans Enfance, d’une charge particulière ». Les romans lus dans la jeunesse, les albums, mais aussi la lecture d’un propre essai d’écriture romanesque permettent de dresser un partage entre réalité et fiction, ainsi que d’esquisser une équivalence entre identité singulière et identité « commune ». La question des genres est posée, mais de manière oblique à travers ces premières expériences de lecture et ouvre sur une distance, voire un soupçon, humoristiques vis-à-vis du genre romanesque.
15Alix Tubman-Mary prolonge l’idée de cette distance avec la lecture par Jean-Paul Goux, de Gracq et de Lautréamont. Ces lectures « remplissent un rôle initiatique, mais aussi émancipateur, plutôt qu’elles ne participent au premier éveil au monde d’une conscience et d’une sensibilité neuves ; elles font l’objet d’une prédilection consciente et d’un choix qui s’oppose à d’autres ». Bien sûr Goux adhère à l’idée de la découverte d’intercesseurs, mais selon un double décalage. D’une part ces lectures sont d’adolescence et non d’enfance et pour être « de la première fois », elles n’en revêtent pas moins une autre dimension. En effet, ces deux « modèles » permettront d’autre part de se libérer des codes génériques traditionnels du roman romanesque. Ainsi s’élabore la conception d’une « prose du continu », où, nous dit Alix Tubman-Mary, « la narration s’appuie moins sur la mise en intrigue que sur l’exploration minutieuse, portée par des voix alternées, des enjeux de "l’acte d’habiter", cherchant dans une approche phénoménologique comment s’entrelacent dans une vie humaine, au plus juste, au plus dense, l’espace et le temps ». Le roman n’est pas le récit poétique : s’il y a découverte d’un enthousiasme, ce n’est pas au sens romantique qu’il faut l’entendre, mais au sens d’une entrée dans un univers où être et écriture relèvent de la même expérience.
16On voit, au terme de ce parcours, que ce qui réunit les études ici rassemblées, c’est la commune fascination, par et dans la lecture, pour la découverte (amoureuse, esthétique, épistémique) d’un « territoire » du littéraire. Cette découverte fournit le point de départ d’une forme de voyage, toujours un peu extraordinaire et positivement aventureux, au pays des genres, pays sans frontières définitives, en perpétuelle et fabuleuse métamorphose. Telle est la puissance de la fable, fable lue et fable du récit de lecture indifféremment, d’introduire à une généricité, constructivement, critique. Et si Saint-John Perse a ouvert cette présentation, on invoquera ici un autre poète pour définir le « génie » du créateur-lecteur comme « enfance retrouvée à volonté ». On pourrait ainsi dire avec Baudelaire, que, dans la lecture de la première fois (mais toute lecture n’est-elle pas de la première fois, sachant qu’on ne lit jamais deux fois le même livre ?), « [t]ous les matériaux dont la mémoire s’est encombrée se classent, se rangent, s’harmonisent et subissent cette idéalisation forcée qui est le résultat d’une perception enfantine, c’est-à-dire d’une perception aiguë, magique à force d’ingénuité !8 » Connaître les genres, c’est peut-être les reconnaître, ou du moins effectuer un va-et-vient permanent, à la fois magique en effet et très empirique (perceptif voire cognitif) qui tient lieu de « miracle banal »9 selon la judicieuse définition de la lecture proposée par Marguerite Yourcenar, entre ce que l’on sait des genres et de la littérature qu’on lit et ce que l’on en ignorait, entre déjà-vu et après-coup.
Notes
1 Le Savoir des genres, R. Baroni et M. Macé (dir.), Rennes, PUR, La Licorne n°79, 2007. Cet ouvrage est représentatif de la nouvelle orientation prise par les travaux sur les genres littéraires, qui consiste à décentrer la réflexion structurale sur les genres en direction d’une réflexion sur la pratique, sur les usages du genre. C’est également dans cette perspective que souhaite s’inscrire ce volume collectif. Voir également, toujours dans La Licorne : Les genres de travers. Littérature et transgénéricité, D. Moncond’huy et H. Scepi (dir.), Rennes, PUR, La Licorne n°82, 2008.
2 « Je n’avais jamais lu encore de vrais romans. J’avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champi quelque chose d’indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l’attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l’inquiétude et la mélancolie, et qu’un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans, me paraissaient simplement – à moi qui considérais un livre nouveau non comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique, n’ayant de raison d’exister qu’en soi – une émanation troublante de l’essence particulière à François le Champi. », Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, I, Du côté de chez Swann [1913], Gallimard, NRF, 1992, p. 46.
3 Le Savoir des genres, op. cit., p. 12.
4 Ibid., p. 9.
5 C. Martin rappelle le rôle fondateur qu’ont joué tout à la fois l’Emile et Les Confessions dans « l’avènement d’une conception moderne de l’enfance » (« L’enfance d’Emile et l’enfant des Confessions », Les Confessions : se dire, tout dire, J. Berchtold et C. Habib (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 33. Pour l’histoire du changement de regard sur l’enfance au XVIIIe siècle, voir l’ouvrage classique de P. Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, Paris, Plon, 1960.
6 Ibid.
7 Formes et Représentations en Linguistique, Littératures et arts de l’Image et de la Scène, EA 3816 – MSHS, Université de Poitiers. L’équipe B2 se donne pour objet d’étude l’Histoire et la Poétique des Genres. http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/equipes/b2-histoire-et-poetique-des-genres/
8 Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, III, « L’artiste, homme du monde, homme des foules et enfant ».
9 Marguerite Yourcenar, Quoi ? L’éternité, Paris, Gallimard, 1988, p. 226.
Pour citer ce document
Droits d'auteur

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/) / Article distribué selon les termes de la licence Creative Commons CC BY-NC.3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/)